

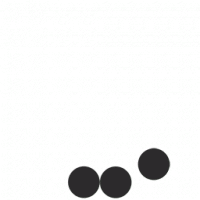

La guerre ne tue pas que les hommes, elle asphyxie aussi la culture et le savoir. Dans les territoires sous occupation de l’Alliance des Forces du Changement – M23 (AFC-M23), les écrivains congolais, autrefois voix de résistance et de mémoire, semblent aujourd’hui réduits au silence. Qu’ils soient en fuite, contraints au mutisme ou disparus, leur absence témoigne d’un drame intellectuel et culturel majeur dans cette partie de la République Démocratique du Congo (RDC). Où sont passés les écrivains des Kivus ?
Avant la récente escalade du conflit, les provinces du Nord et du Sud-Kivu regorgeaient d’auteurs, romanciers, historiens et poètes qui décrivaient, avec talent et courage, les réalités d’une région marquée par des décennies d’instabilité. Goma, Bukavu, Rutshuru ou Masisi étaient des centres de création littéraire où se tenaient des salons du livre, des conférences et des rencontres entre intellectuels. Mais depuis l’avancée de l’AFC-M23, le silence règne.
Certains écrivains ont fui vers Kinshasa, Lubumbashi ou l’étranger, tandis que d’autres ont cessé toute publication par peur de représailles. Quelques rares voix continuent de s’exprimer clandestinement, via des réseaux sociaux ou des plateformes anonymes, dénonçant l’oppression et le pillage des ressources culturelles et intellectuelles.
L’un d’eux, un romancier originaire de Goma qui a choisi de garder l’anonymat, raconte :
« Il y a quelques années encore, nous pouvions tenir des cercles littéraires et publier nos textes sans craindre pour nos vies. Aujourd’hui, il ne reste que la clandestinité ou le silence. Certains de mes amis écrivains sont en fuite, d’autres ont disparu. Personnellement, j’ai dû brûler certains de mes manuscrits pour éviter qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains. Il ne s’agit pas seulement de réprimer les écrivains, mais bien de les effacer de l’histoire. »
Dans les zones occupées, l’AFC-M23 impose un contrôle strict sur l’expression publique. Les bibliothèques sont fermées ou pillées, les librairies désertées, et les écoles privées de programmes littéraires congolais. Les œuvres traitant du nationalisme, de la souveraineté congolaise ou de la mémoire des conflits sont souvent interdites.
Un enseignant de Bukavu, lui aussi écrivain, témoigne sous couvert d’anonymat :
« Aujourd’hui, il est risqué d’évoquer des auteurs qui parlent de résistance ou de lutte contre l’oppression. Je dirais qu’on nous impose d’autres références, d’autres récits. »
Les écrivains qui restent en Kivu vivent sous la menace permanente. Certains ont été arrêtés, accusés d’incitation à la haine ou d’activités subversives. D’autres sont portés disparus, leurs familles n’ayant plus de nouvelles d’eux depuis plusieurs mois.
Au-delà des écrivains eux-mêmes, c’est tout un pan du patrimoine culturel congolais qui est en péril. Des manuscrits inédits ont été perdus ou détruits. Des maisons d’édition locales ont fermé leurs portes, incapables de poursuivre leurs activités dans ce contexte de guerre et de répression. Certains chercheurs estiment que cette crise s’inscrit dans un processus plus large d’effacement de l’identité culturelle congolaise dans l’Est du pays.
Cependant, même réduits au silence, certains auteurs tentent de résister. Un poète réfugié à Lubumbashi exprime son combat par des écrits diffusés de manière anonyme :
« L’histoire nous a appris que l’oppression n’a jamais étouffé la parole libre. Aujourd’hui, nous écrivons sous pseudonyme, nous diffusons nos textes sur des réseaux confidentiels, mais nous écrivons encore. Tant qu’un seul auteur congolais existera, notre mémoire ne disparaîtra pas. Le pouvoir d’un livre est plus grand que celui d’une arme, et c’est pour cela qu’ils veulent nous faire taire. »
Face à cette situation, des associations d’écrivains congolais et africains tentent d’alerter la communauté internationale. Des initiatives de soutien voient le jour, notamment pour aider les écrivains à poursuivre leurs publications.
À Kinshasa et Lubumbashi, certains éditeurs et intellectuels militent pour la création d’un fonds spécial de soutien aux écrivains déplacés, ainsi que pour la numérisation et l’archivage des œuvres menacées.
Malgré tout, l’histoire a montré que la répression n’a jamais étouffé la littérature. Dans les zones en crise, de nouvelles formes de résistance émergent, comme la poésie engagée diffusée clandestinement ou les récits publiés sous pseudonyme. Les écrivains du Kivu, même en exil ou réduits au silence, demeurent les gardiens d’une mémoire que ni la guerre ni l’occupation ne pourront effacer. Il reste à espérer que le jour viendra où leurs voix pourront de nouveau s’élever librement, témoignant de la douleur d’aujourd’hui, mais aussi de l’espoir d’un Kivu libre et debout.
