

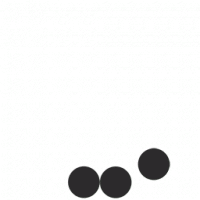

Depuis la résurgence des hostilités en 2021, la République Démocratique du Congo (RDC) est confrontée à une guerre imposée par le Rwanda, à travers son soutien au mouvement rebelle M23. La prise de Goma en janvier 2025, suivie de celle de Bukavu, marque une escalade dramatique dans ce conflit, exacerbant une crise humanitaire déjà critique dans l’est du pays. Dans ce contexte, les scientifiques congolais, en tant qu’acteurs clés de la société, portent une responsabilité particulière. Leur rôle ne se limite pas à la production de connaissances, mais s’étend à l’engagement social, à la défense de la souveraineté nationale et à la contribution à la résilience des communautés affectées. Cet article explore les responsabilités des scientifiques congolais dans cette période de guerre, en mettant en lumière leurs devoirs éthiques, scientifiques et citoyens.
Contexte historique et géopolitique
Le conflit actuel s’inscrit dans une longue histoire de tensions entre la RDC et le Rwanda, dont les racines remontent au génocide des Tutsis de 1994. À l’époque, des génocidaires hutus se sont réfugiés dans l’est de la RDC, formant des groupes armés comme les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Le Rwanda, sous la présidence de Paul Kagame, justifie ses interventions militaires par la nécessité de neutraliser cette menace. Cependant, des rapports de l’ONU et d’autres sources crédibles, y compris un rapport de juillet 2024, ont établi que les Forces de Défense Rwandaises (FDR) exercent un contrôle de facto sur les opérations du M23, utilisant ce groupe comme un instrument pour leurs ambitions territoriales et économiques. La prise de Goma et de Bukavu par le M23, soutenue par environ 4 000 soldats rwandais, a non seulement provoqué le déplacement de 1,5 million de personnes, mais a également permis au Rwanda de renforcer son emprise sur les ressources minières de la région, notamment le coltan, le cobalt et l’or.
Ce conflit, souvent présenté comme une guerre civile congolaise, est en réalité une agression interétatique, où le Rwanda cherche à maintenir une sphère d’influence dans les Kivus, au détriment de la souveraineté congolaise. Les scientifiques congolais, en tant que témoins et acteurs de cette crise, ont un rôle crucial à jouer pour contrer cette narrative et contribuer à des solutions durables.
Responsabilité éthique : documenter et dénoncer les abus
Les scientifiques congolais, qu’ils soient sociologues, anthropologues, historiens ou experts en relations internationales, portent une responsabilité éthique majeure dans la documentation des abus perpétrés dans le cadre de ce conflit. Trop souvent, ces données cruciales restent absentes des rapports officiels internationaux. En l’absence d’une recherche rigoureuse de leur part, les scientifiques congolais assument une responsabilité directe dans la mise à jour et la diffusion d’informations fiables, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux et à la préservation de la vérité historique.
Les rapports de l’ONU et d’organisations comme Human Rights Watch ont signalé des exactions graves, notamment des exécutions sommaires par le M23, des violences sexuelles perpétrées par les troupes congolaises et rwandaises, et des déplacements forcés de populations. À Kinshasa, des manifestations ont vu des citoyens brûler des portraits de Paul Kagame, exprimant leur colère face à l’inaction internationale. Les chercheurs congolais doivent amplifier ces voix en produisant des études rigoureuses qui exposent les violations des droits humains et les dynamiques de prédation économique. Ils ne doivent pas se limiter aux simples discussions et débats internes.
Par exemple, les géologues et économistes peuvent analyser l’impact de l’exploitation illégale des minerais par le M23 et le Rwanda. Selon un rapport de l’ONU, le M23 exporte 120 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda, générant des revenus estimés à 800 000 dollars mensuels, qui servent à financer ses opérations militaires. Les scientifiques congolais doivent collaborer avec des institutions internationales pour établir des bases de données fiables sur ces flux illégaux, contribuant ainsi à des plaidoyers pour des sanctions ciblées contre les responsables rwandais et leurs complices.
Responsabilité scientifique : contribuer à la résilience des communautés
Dans un contexte de crise humanitaire, où 1,5 million de personnes vivent dans des camps de fortune autour de Goma, les scientifiques congolais ont un rôle à jouer dans le renforcement de la résilience des communautés affectées. Les psychologues cliniques et sociaux, par exemple, peuvent accompagner les populations à développer des mécanismes d’adaptation, concevoir et appliquer les enseignements spécifiques, conçus pour des programmes de soutien psychologique adaptés aux déplacés de guerre, en tenant compte des traumatismes liés aux violences sexuelles et aux pertes familiales.
Les scientifiques spécialisés en santé publique ont également un rôle crucial. La guerre a exacerbé les problèmes sanitaires dans l’est de la RDC, avec des épidémies de maladies comme le choléra et la malnutrition affectant les populations déplacées. Les épidémiologistes congolais doivent travailler à la mise en place de systèmes de surveillance des maladies, en collaboration avec des organisations comme Médecins Sans Frontières, qui a signalé des affrontements quasi-quotidiens à Masisi en février 2025. De plus, les ingénieurs agronomes peuvent développer des solutions pour assurer la sécurité alimentaire dans les zones de conflit, en promouvant des cultures résistantes et des techniques agricoles adaptées aux déplacements fréquents des populations.
Responsabilité citoyenne : défendre la souveraineté nationale
En tant que citoyens, les scientifiques congolais ont le devoir de défendre la souveraineté de leur pays face à l’agression rwandaise. Cela implique de participer activement au débat public et de contrer les récits qui minimisent l’implication du Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a souvent présenté le conflit comme un problème interne à la RDC, une narrative qui a longtemps été acceptée par une partie de la communauté internationale. Cependant, la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU du 21 février 2025, qui a condamné pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23, marque un tournant. Les chercheurs congolais doivent s’appuyer sur cette reconnaissance pour exiger des sanctions internationales, comme un embargo sur les exportations de minerais rwandais, comme l’a proposé la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Les historiens et politologues congolais peuvent également contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques régionales. Le Rwanda justifie ses interventions par la présence des FDLR, mais cette menace est souvent exagérée pour masquer des ambitions économiques et territoriales. Les chercheurs doivent produire des analyses historiques qui retracent l’évolution des relations entre la RDC et le Rwanda, en mettant en lumière les continuités entre les guerres des années 1990 et le conflit actuel. Cela permettrait de mieux contextualiser les revendications congolaises et de renforcer la position de Kinshasa dans les négociations internationales.
Mais alors, quels sont les défis et obstacles auxquels sont confrontés les scientifiques congolais ?
Les scientifiques congolais font face à plusieurs défis dans l’exercice de leurs responsabilités. Premièrement, l’insécurité dans les zones de conflit limite l’accès aux terrains d’étude. Les affrontements près d’Ihusi, à 60 km de Bukavu, en février 2025, illustrent la difficulté de mener des recherches sur le terrain. Deuxièmement, le manque de financement et d’infrastructures de recherche en RDC entrave la production de connaissances. Enfin, la polarisation politique et les pressions du gouvernement peuvent compromettre l’indépendance des chercheurs, amplifiant ainsi leur peur et difficulté à être productif.
De ce qui précède, notons qu’en cette période de guerre à laquelle fait face la RD Congo, les scientifiques congolais portent une triple responsabilité : éthique, scientifique et citoyenne. Ils doivent documenter les abus, contribuer à la résilience des communautés et défendre la souveraineté nationale à travers des recherches rigoureuses et un engagement actif dans le débat public. Malgré les nombreux défis, leur rôle est indispensable pour éclairer les dynamiques du conflit, soutenir les populations affectées et faire pression pour une résolution juste et durable.
