

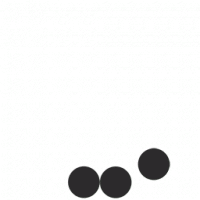

Une étude publiée dans Nature révèle une lignée génétique nord-africaine jusqu’alors inconnue, issue de la période humide africaine datant de 7 000 ans. En analysant des génomes anciens de Taforalt (Maroc) et Takarkori (Libye), les chercheurs démontrent des connexions insoupçonnées entre les populations préhistoriques du Sahara et du Maghreb. Ces résultats offrent de nouvelles perspectives sur les migrations humaines et les échanges culturels à travers la région.
Les génomes anciens issus de la période du « Sahara vert » apportent un éclairage inédit sur l’Afrique du Nord. Les données recueillies sur les sites de Taforalt et Takarkori mettent en évidence une lignée liée à l’industrie lithique ibéromaurusienne, en lien direct avec les trouvailles marocaines. Selon une étude publiée le 2 avril dans la revue scientifique Nature, ces résultats marquent
une première étape cruciale pour de futures recherches génétiques, susceptibles de révéler davantage sur les flux migratoires à travers le Sahara.
Cette recherche, réalisée par des scientifiques de Libye, du Maroc, d’Afrique du Sud et d’Europe, s’appuie sur des données génomiques issues de deux femmes du Néolithique pastoral, inhumées dans l’abri sous roche de Takarkori.
La majorité de l’ascendance de ces individus provient d’une lignée génétique nord-africaine jusqu’alors inconnue, qui s’est séparée des lignées d’Afrique subsaharienne à la même époque que les humains modernes hors d’Afrique et est restée isolée pendant la majeure partie de son existence, expliquent les auteurs.
Les chercheurs précisent que les individus de Takarkori sont proches génétiquement des chasseurs-cueilleurs de Taforalt, datant de 15 000 ans. Toutefois, contrairement à ces derniers,
qui possèdent la moitié du mélange néandertalien des non-Africains, Takarkori présente dix fois moins d’ascendance néandertalienne que les agriculteurs levantins, mais significativement plus que les génomes subsahariens contemporains, révèlent-ils.
Les résultats de cette étude suggèrent que le pastoralisme s’est diffusé
par transmission culturelle au sein d’une lignée nord-africaine profondément divergente et isolée, probablement répandue en Afrique du Nord à la fin du Pléistocène.
Ces conclusions renforcent des travaux antérieurs, selon lesquels les premières données d’ADN ancien à l’échelle du génome nord-africain néolithique révèlent « une ascendance dérivée d’un pool génétique ‘maghrébin’, apparenté à des individus bien plus anciens » de l’âge de pierre tardif à Taforalt.
Après le séquençage d’un génome au Maroc, des éléments provenant de sites en Algérie et en Tunisie ont permis d’explorer les mobilités entre l’Asie, l’Europe et le Maghreb durant le développement de la culture de production locale.
