

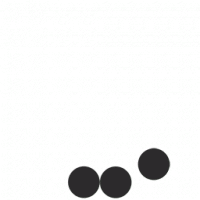

Saqqara, Égypte — Une énigme millénaire pourrait enfin trouver une réponse. Une nouvelle étude scientifique, publiée dans la revue PLOS One, bouleverse notre compréhension des techniques de construction des pyramides de l’Égypte ancienne. Des chercheurs, dirigés par l’égyptologue français Xavier Landreau, avancent une hypothèse révolutionnaire : un système hydraulique sophistiqué, alimenté par les eaux du Nil, aurait permis de hisser les lourdes pierres de la pyramide de Djoser à Saqqara, vieille de plus de 4 500 ans.
La pyramide à degrés de Djoser, considérée comme la première grande œuvre monumentale en pierre de l’histoire de l’humanité, aurait ainsi été érigée à l’aide d’un système de levage utilisant la puissance de l’eau — une technologie que l’on croyait jusqu’à présent hors de portée des civilisations de l’Antiquité.
Les chercheurs se sont intéressés à une structure longtemps restée inexpliquée à proximité du complexe funéraire de Djoser. Selon leur analyse, confirmée par des relevés de terrain et des modélisations, il s’agirait d’un barrage de retenue, accompagné d’une station d’épuration rudimentaire et d’un mécanisme de levage.
Ces installations auraient été reliées entre elles et fonctionnaient grâce à un ancien bras du Nil aujourd’hui asséché. Le barrage, selon les spécialistes, permettait de stocker et de purifier l’eau, tandis que l’ascenseur hydraulique utilisait la force de cette eau régulée pour soulever les blocs de pierre jusqu’au chantier.
Ensemble, ces structures formaient un système unifié destiné à contrôler la qualité de l’eau et à en réguler le débit à des fins précises », explique Xavier Landreau. « Notre hypothèse : l’eau ainsi maîtrisée aurait servi à activer un mécanisme de levage, réduisant considérablement l’effort humain nécessaire à la construction. »
Cette découverte relance le débat sur le niveau de sophistication technologique de l’Égypte antique. Si l’usage de rampes en bois et en pierre reste l’explication dominante depuis des siècles, cette nouvelle hypothèse ouvre la voie à des interprétations plus complexes et, peut-être, plus proches de la réalité.
L’étude cite également le site de Gisr el-Mudir, souvent négligé par les archéologues, comme une preuve complémentaire. Ce dernier montre des caractéristiques typiques d’un système de rétention d’eau et de gestion des sédiments, renforçant la thèse d’un contrôle hydraulique avancé.
La communauté scientifique reste prudente, mais intriguée. Plusieurs spécialistes en archéologie et en ingénierie ancienne saluent la rigueur de l’étude et appellent à de nouvelles fouilles pour confirmer cette hypothèse.
Si ce système est avéré, il pourrait transformer notre lecture de toute l’ingénierie monumentale de l’Égypte antique », estime la professeure américaine Linda Schultz, de l’Université de Chicago. « Cela suppose une maîtrise de l’hydraulique, de la mécanique et de l’organisation collective bien supérieure à ce que nous imaginions. »
L’équipe de Xavier Landreau prévoit de poursuivre ses investigations sur d’autres sites égyptiens, dans l’espoir de retrouver des traces similaires de systèmes hydrauliques oubliés. Une campagne de fouilles est déjà en préparation pour l’automne 2025.
En attendant, cette découverte invite le monde à regarder les pyramides non seulement comme des merveilles esthétiques, mais aussi comme les témoignages d’un savoir technique et scientifique d’une civilisation visionnaire.
